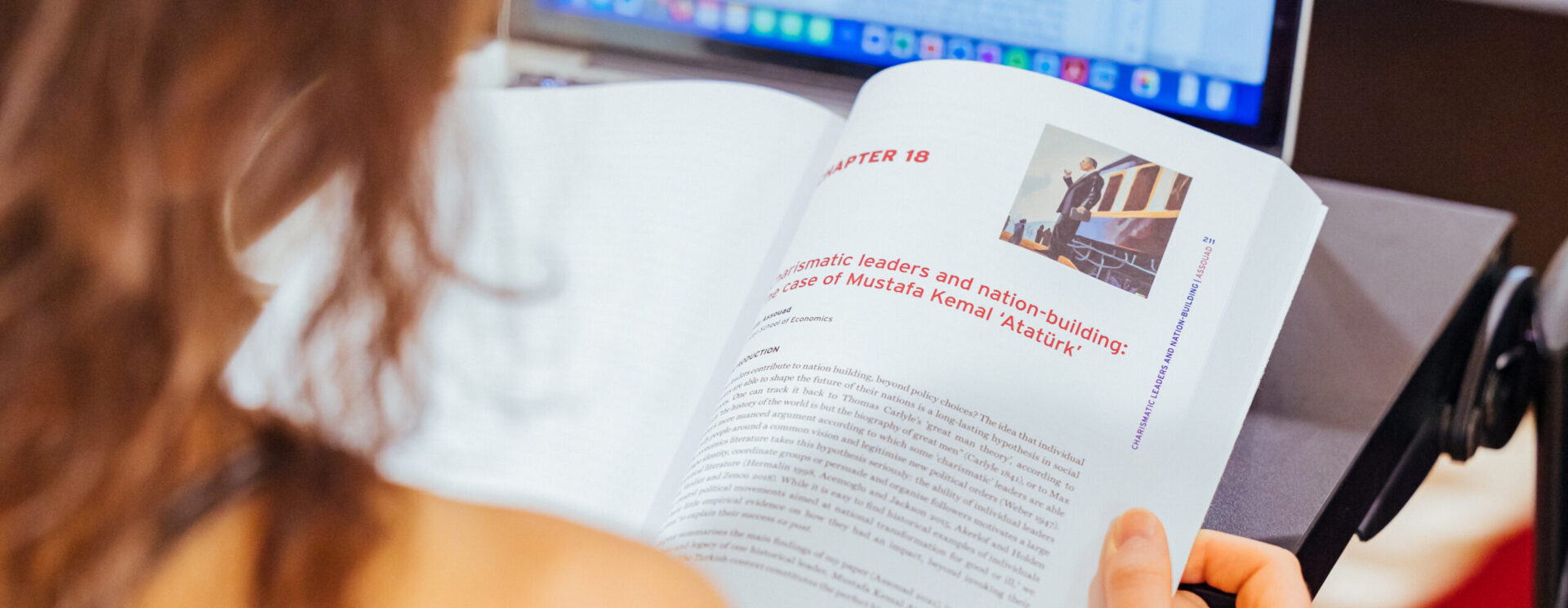Publié en
Publications des chercheurs de PSE
Affichage des résultats 1 à 12 sur 45 au total.
-
Accounting for Wealth Inequality Dynamics: Methods, Estimates and Simulations for France Pré-publication, Document de travail:Auteur(s) : Thomas Piketty
-
Appendix to "Income Inequality in France, 1900-2014: Evidence from Distributional National Accounts Pré-publication, Document de travail:Auteur(s) : Thomas Piketty
Publié en
-
Inégaux dès le berceau : des SMS pour améliorer les interactions langagières entre parents et enfants de familles défavorisées ? Autre publication scientifique:Auteur(s) : Clement De Chaisemartin, Marc Gurgand, Sophie Kern
Publié en
-
Predistribution vs. Redistribution: Evidence from France and the U.S Pré-publication, Document de travail:Auteur(s) : Antoine Bozio, Thomas Piketty
Publié en
-
Les sciences humaines et sociales face à la première vague de la pandémie de Covid-19 -Enjeux et formes de la recherche Rapport:Auteur(s) : Carine Milcent
Publié en
-
Lutter contre les inégalités dès la petite enfance : évaluation à grande échelle du programme Parler Bambin Autre publication scientifique:Auteur(s) : Clement De Chaisemartin, Marc Gurgand, Sophie Kern
Publié en
-
Another brick in the wall. Immigration and electoral preferences: Direct evidence from state ballots Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Valette, Victor Stephane Revue : Review of International Economics
Publié en
-
Tax Design, Information, and Elasticities: Evidence From the French Wealth Tax Pré-publication, Document de travail:Auteur(s) : Gabriel Zucman
Publié en
-
The Political Costs of Taxation Pré-publication, Document de travail:Auteur(s) : Eva Davoine, Joseph Enguehard
Publié en
-
From Evolutionary Biology to Economics and Back Ouvrages:Auteur(s) : Jean Gayon, Jean-Baptiste André, Mikaël Cozic Éditeur(s) : Springer International Publishing
Publié en
-
Méthodes d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des enjeux socio-économiques associés aux plantes obtenues au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques (NTG) Rapport:Auteur(s) : Bénédicte Apouey
Publié en
-
Moustique tigre en France hexagonale : risque et impacts d’une arbovirose Rapport:Auteur(s) : Bénédicte Apouey
Publié en