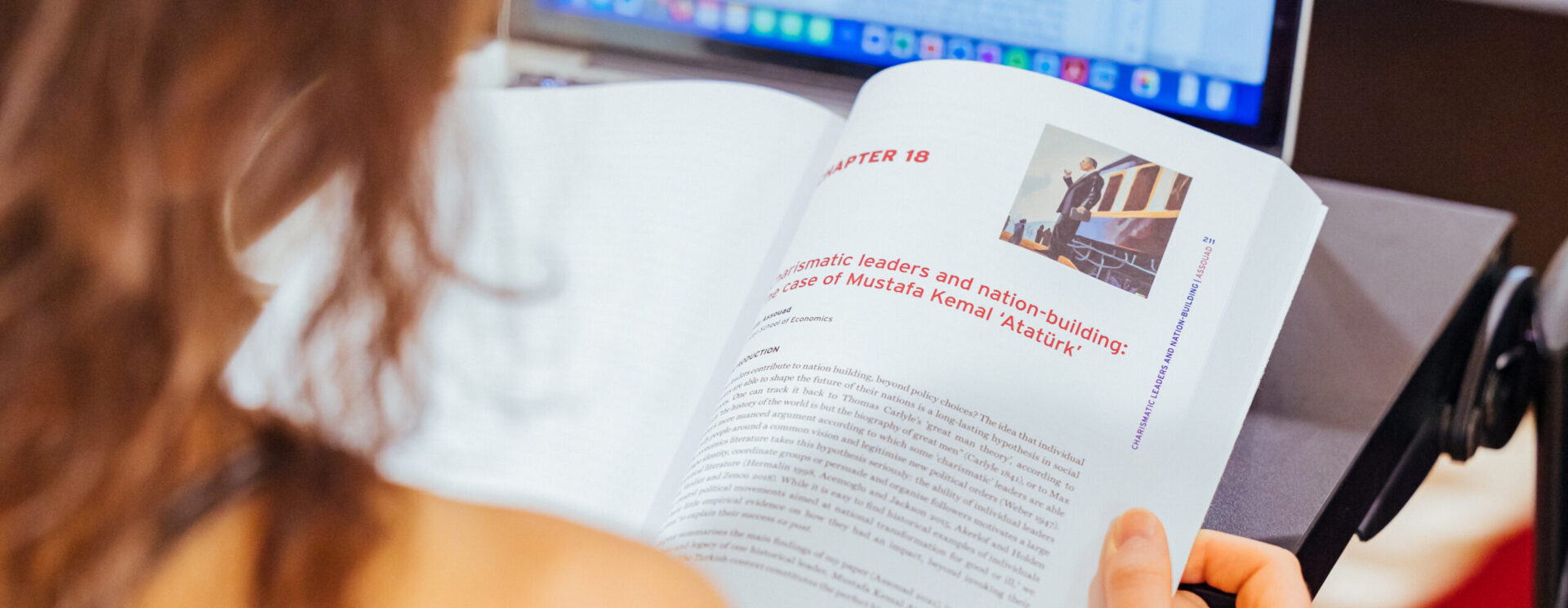Publié en
Publications des chercheurs de PSE
Affichage des résultats 1 à 12 sur 20 au total.
-
Anti (sciences) sociales, tu perds ton sang-froid ! Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu Revue : Actes de la Recherche en Sciences Sociales
-
Étudier les représentants du personnel pour mieux comprendre les relations de travail et les conditions du partage de la valeur ajoutée Rapport:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Thomas Breda
Publié en
-
Intergenerational Wealth Mobility in France, 19th and 20th Century Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum, Akiko Suwa-Eisenmann Revue : Review of Income and Wealth
Publié en
-
Des délégués syndicaux sous-payés : une situation de discrimination stratégique ?Une analyse économétrique à partir de l’enquête REPONSE de 2010 Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Thomas Breda Revue : Travail et Emploi
Publié en
-
L'enquête TRA, histoire d'un outil, outil pour l'histoire : Tome 1 (1793-1902) Ouvrages:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum Éditeur(s) : INED
Publié en
-
The true social molecule'. Industrialization, paternalism and the family. Half a century in Le Creusot (1836-86) Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum Revue : The History of the Family
Publié en
-
L’enquête TRA, une matrice d’histoire Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum Revue : Population (édition française)
Publié en
-
Montant et composition du patrimoine des indépendants, avant et après le départ à la retraite Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu Revue : Economie et Statistique / Economics and Statistics
Publié en
-
Thrifty Pensioners: Pensions and Savings in France at the Turn of the Twentieth Century Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum Revue : Journal of Economic History
Publié en
-
Patrimoine et retraite : l'expérience française de 1820 à 1940 Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum Revue : Economie et Statistique / Economics and Statistics
Publié en
-
Mobilité intergénérationnelle du patrimoine en France aux XIXe et XXe siècles Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Akiko Suwa-Eisenmann Revue : Economie et Statistique / Economics and Statistics
Publié en
-
Vive la différence? Intergenerational Mobility in France and the United States during the Nineteenth and Twentieth Centuries Article dans une revue:Auteur(s) : Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum Revue : Journal of Interdisciplinary History
Publié en