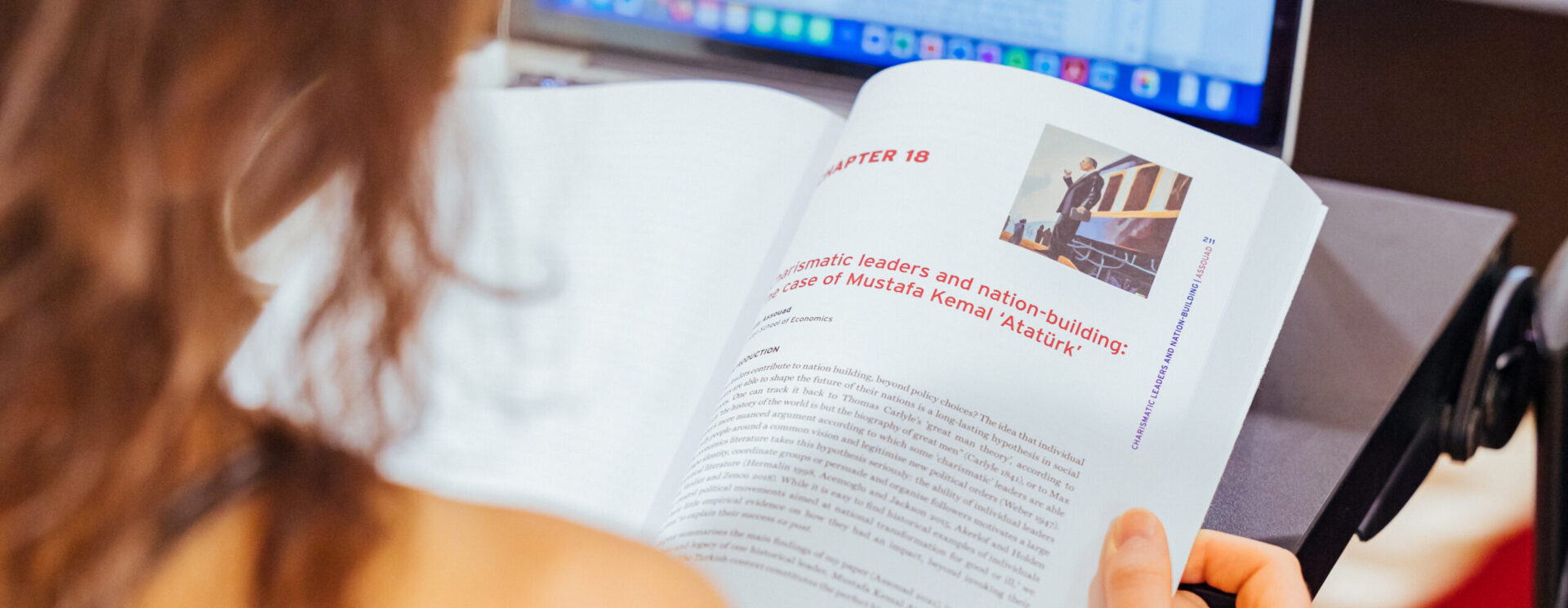Caractérisation dosimétrique et évaluation des lésions radio-induites après irradiation dans les conditions de la radiologie interventionnelle
Thèse: À la fin du XIXème siècle, suite à la découverte des rayons-X par Wilhelm Röntgen, l'utilisation des rayonnements ionisants se développe dans différents domaines notamment dans le domaine médical. En effet, l'apparition de la radiologie interventionnelle en 1953 révolutionne le traitement des patients. Cette technique, guidée par une imagerie de rayons-X de basse énergie (70 à 120 kV), est utilisée aussi bien pour le diagnostic que le traitement de diverses pathologies. En 60 ans, elle est devenue incontournable, regroupant plus de 600 types d'actes notamment en cardiologie ou neurologie. En France, on compte plus de 600 000 actes par an et ce nombre est en constante augmentation. Bien que cette technique, moins invasive que de la chirurgie classique, soit un atout indéniable pour le patient et majoritairement maitrisée, des surexpositions accidentelles peuvent se produire. Ces accidents restent rares mais peuvent entrainer l'apparition d'effets déterministes, allant de l'érythème à la nécrose lorsque des doses supérieures à 10 Gy sont délivrées localement aux tissus. Même si les effets secondaires les plus souvent observés lors de ces surexpositions sont cutanés, la spécificité des rayons-X de basse énergie où le dépôt de dose dépend beaucoup de la composition et de la densité du tissu traversé, peut conduire à de forts gradients de dose. Ainsi, les doses dans des milieux denses (os) ou adjacents aux milieux denses peuvent être beaucoup plus élevées que la dose cutanée. Le manque de connaissances sur les conséquences et les effets radiobiologiques de ce type d'exposition (basse énergie) où l'hétérogénéité du dépôt de dose peut être importante, rend le pronostic du patient incertain. L'objectif de ce projet est de contribuer au développement d'un nouveau modèle d'irradiation préclinique capable de reproduire des surexpositions accidentelles en radiologie interventionnelle, afin de mieux comprendre les conséquences radiobiologiques et les spécificités de ce type d'exposition à travers une caractérisation dosimétrique et radiopathologique. Pour cela, un nouveau modèle d'irradiation localisée de la patte chez la souris à basse énergie (80 kV) a été mis en place sur le SARRP avec 5 protocoles d'exposition (dose unique : 15, 30 et 45 Gy ou répétée : 2 et 3×15 Gy avec 1 semaine d'intervalle) et 6 temps d'euthanasie post-irradiation (J0 à J84). Les mesures dosimétriques par spectroscopie par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) sur l'os, à J0 et les simulations mettent en évidence la forte hétérogénéité du dépôt de dose et la forte dépendance de la composition des matériaux à basse énergie. Les mesures RPE sur l'os au cours du temps, réalisées pour la toute première fois sur un modèle préclinique in vivo, montrent une perte de signal probablement dû au renouvèlement osseux. Dans un contexte de dosimétrie rétrospective lors d'un accident radiologique, une sous-estimation de la dose est possible si le prélèvement est réalisé plusieurs mois après l'irradiation. L'évaluation macroscopique des lésions radio-induites, via du scoring lésionnel, des pesées et des mesures au laser Doppler caractérisant le flux sanguin a permis de classer les protocoles d'irradiation. Des analyses histologiques et microCT sur les tissus osseux et musculaires ont montré une modification de la densité des muscles irradiés et une perte du volume d'os trabéculaire aux temps tardifs. Pour conclure, dans ce travail, le nouveau modèle d'irradiation localisé, utilisant des rayons-X de basse énergie a été caractérisé dosimétriquement et radiopathologiquement. Il a permis de mettre en évidence les spécificités de ce type d'exposition, améliorer les connaissances sur les conséquences de ces expositions et améliorer la prédiction du risque des complications liées aux expositions en radiologie interventionnelle.
Mots-clés
- Radiologie Interventionnelle
- Dosimétrie
- Simulation Monte Carlo
- Radiobiologie
- Accidents
Organisme(s) de délivrance
- Université Paris-Saclay
Date de soutenance
- 19/09/2023
Directeur(s) de thèse
- Yolanda Prezado
- Morgane Dos Santos
URL de la notice HAL
Version
- 1