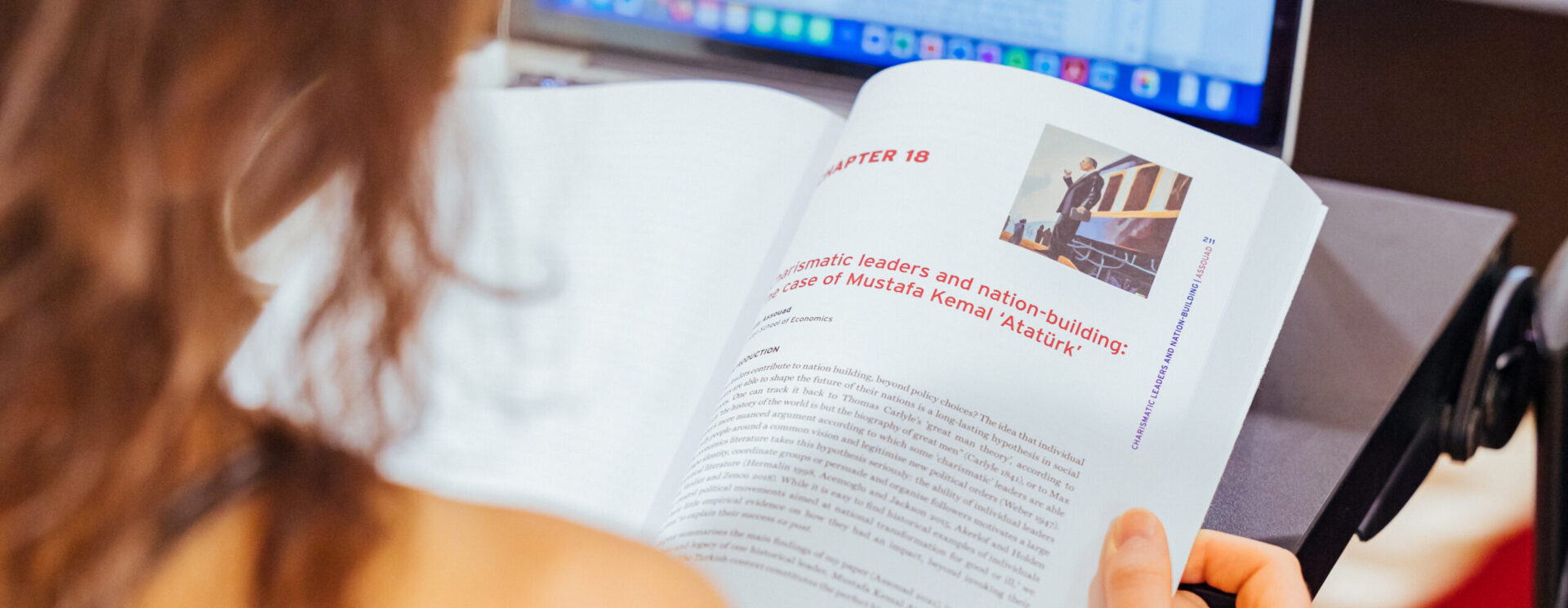Non aes sed fides. Réflexions sur le pouvoir de la monnaie
Article dans une revue: Au fondement de l’approche institutionnaliste, on trouve la thèse selon laquelle la monnaie résulte d’un processus collectif d’élection grâce auquel une communauté de producteurs de marchandises construit sa cohésion en faisant émerger une représentation partagée de la valeur, à savoir l’unité de compte. Cette conception qui appréhende la monnaie comme un fait communautaire s’oppose à la fois à la conception instrumentaliste, défendue par la théorie néoclassique, selon laquelle la monnaie est un simple moyen technique facilitant les échanges, et à l’approche chartaliste selon laquelle la monnaie est une créature de l’État. Dans la perspective institutionnaliste, la monnaie tire son autorité de la confiance du groupe marchand qui l’a élue. Du fait de l’investissement collectif dont elle fait l’objet, la croyance monétaire se voit dotée d’une puissance autonome que l’État ne contrôle pas et qui s’impose à lui. Une part de la confiance monétaire – qu’on nomme « la confiance éthique » – a pour enjeu les valeurs que l’institution monétaire défend. C’est ce que montre l’exemple du bitcoin. En effet, l’idée même d’une monnaie digitale affranchie de toute institution centrale a été élaborée au sein du mouvement « crypto-anarchiste », dans le but explicite de proposer une architecture institutionnelle d’échanges qui soit pleinement conforme aux valeurs et aux réquisits idéologiques de ce mouvement.
Auteur(s)
André Orléan
Revue
- Revue Française d’Histoire Economique
Date de publication
- 2022
Mots-clés JEL
Mots-clés
- Bitcoin
- Confiance
- Institutionalisme
- Souveraineté
- Unité de compte
Pages
- 8-21
URL de la notice HAL
Version
- 1
Volume
- 2022/2