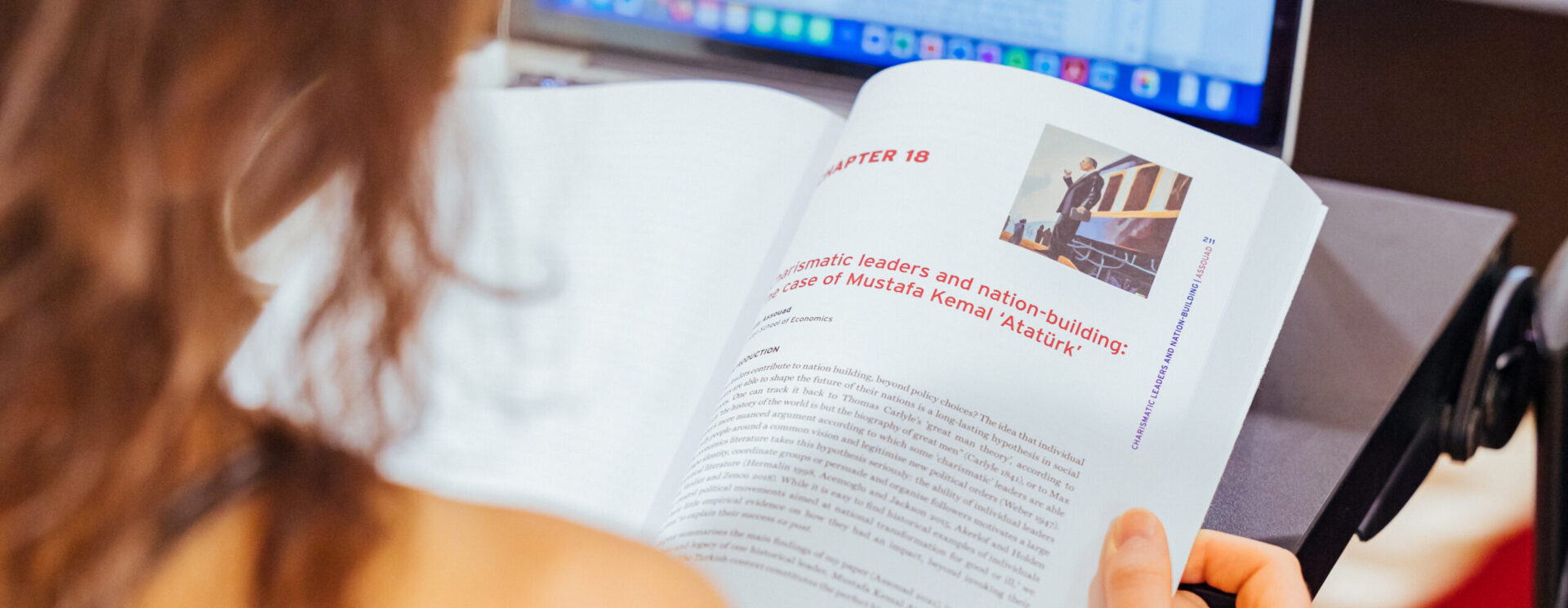Trois Essais sur les Progrès de la Santé et le Développement Économique en Afrique
Thèse: Cette thèse a pour ambition d’ouvrir la boîte noire que constituent les progrès de la santé en Afrique au XXème siècle. Ce faisant, elle apporte trois contributions à la littérature portant sur les investissements de santé, les conditions de santé et la fécondité en Afrique au XXème siècle. Le premier chapitre compare la stratégie de l’administration coloniale en ce qui concerne les politiques de santé à sa stratégie pour d’autres politiques coloniales dans l’ex-Afrique Occidentale Française entre 1904 et 1958. Ce chapitre utilise des archives coloniales et des données existantes pour créer une base de données inédite sur les investissements au niveau des cercles coloniaux: personnels de santé et d’enseignement, vaccinations, dépenses de travaux publics et conscription. La provision de politiques coloniales était déterminée par une stratégie très générale et l’allocation des politiques de santé n’est spécifique que selon deux dimensions. Le personnel de santé était mobilisé pour “couvrir” le territoire conquis et l’effet de longue durée de la prévention menait à une stratégie de “diversification” pour tous les investissements de santé. En dehors de ces spécificités, les facteurs communs à tous les investissements coloniaux sont liés à la préférence de l’administration coloniale pour une dépendance au sentier des investissements, aux rendements d’échelle des investissements, au risque de transmission de maladies et à la demande pour les services coloniaux. Ce chapitre suggère aussi que l’administration ne visait pas une spécialisation des districts par type d’investissements. Le second chapitre étudie la relation entre la taille à l’âge adulte et la mortalité avant cinq ans en Afrique de l’Ouest, dans le contexte du “double paradoxe Africain”. Les Africains sont relativement grands, malgré un environnement sanitaire dégradé et des revenus relativement bas. De plus, leur taille à l’âge adulte a diminué depuis 1960, malgré une amélioration des conditions de santé, et une diminution de la mortalité avant cinq ans. Ce travail suggère qu’une partie de ce paradoxe s’explique par la mortalité sélective, en mettant en avant une corrélation positive entre la taille des mères et la mortalité, dans l’Afrique de l’Ouest des années 80. Ce chapitre propose une modélisation inédite du différentiel de taille entre survivants et décédés. L’estimation de ce modèle indique qu’on ne peut pas exclure qu’en l’absence de sélection par la mortalité, les tailles adultes auraient augmenté, plutôt que stagné, pendant les années 80. Dans des contextes de forte mortalité, les études anthropométriques doivent discuter des niveaux et des tendances de mortalité, afin de prendre en compte la mortalité sélective. Plus généralement, les résultats de ce travail impliquent que la question de la sélection par la mortalité est essentielle pour évaluer l’impact de long-terme de la plupart des politiques de santé. Le troisième chapitre traite d’une autre spécificité de la santé en Afrique: le lien entre fécondité et préférences de genre. Ce chapitre développe un indicateur des préférences de genre fondé sur les intervalles de naissance observés. Cet indicateur est ensuite appliqué au cas de l’Afrique. La préférence pour les garçons est à la fois forte et croissante dans le temps en Afrique du Nord, alors que les pays d’Afrique sub-Saharienne sont caractérisés par une préférence pour la variété, ou par une absence de préférence de genre. Les systèmes familiaux traditionnels prédisent avec précision le type de préférence, ce qui n’est pas le cas de la religion déclarée. Enfin, la magnitude des préférences de genre est plus importante pour les femmes plus riches et/ou plus éduquées.
Mots-clés
- Afrique
- Politiques Coloniales
- Maladies
- Fertilité
- Préférences selon le sexe
- Santé
- Taille
- Mortalité en dessous de cinq ans
Organisme(s) de délivrance
- EHESS – Paris
Date de soutenance
- 03/07/2015
Directeur(s) de thèse
- Denis Cogneau
URL de la notice HAL
Version
- 1